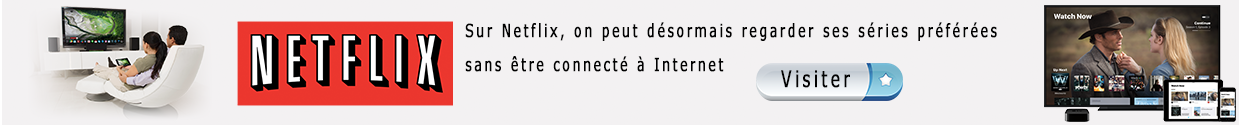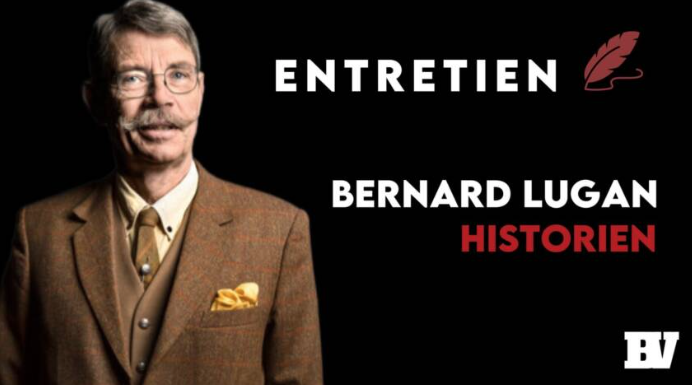Gabrielle Cluzel. Bernard Lugan, vous publiez, le 9 février prochain, une Histoire du Sahel, des origines à nos jours (Éditions du Rocher) indispensable pour comprendre les menaces du monde d’aujourd’hui. Pour vous, il est important de connaître cette Histoire. Vous pensez que l’on sous-estime ce facteur ?
Bernard Lugan. Les décideurs français n’ont pas vu que les actuels conflits sahéliens sont d’abord des résurgences « modernisées » de ceux d’hier, qu’inscrits dans une longue chaîne d’événements, ils expliquent ceux d’aujourd’hui.
Avant la colonisation, les sédentaires sudistes étaient pris dans la tenaille prédatrice des nomades. Une donnée commune à tout le Sahel, du Sénégal au Tchad où nous retrouvons la même problématique. À la fin du XIXe siècle, la colonisation bloqua l’expansion des entités prédatrices nomades dont l’écroulement se fit dans l’allégresse des sédentaires qu’elles exploitaient, dont elles massacraient les hommes et vendaient les femmes et les enfants aux esclavagistes du monde arabo-musulman.
Mais, ce faisant, la colonisation renversa les rapports de force locaux en offrant une revanche aux victimes de la longue histoire africaine, tout en rassemblant razzieurs et razziés dans les limites administratives de l’AOF (Afrique-Occidentale française). Or, avec les indépendances, les délimitations administratives internes à ce vaste ensemble devinrent des frontières d’États à l’intérieur desquelles, comme ils étaient les plus nombreux, les sédentaires l’emportèrent politiquement sur les nomades, selon les lois immuables de l’ethno-mathématique électorale. Les anciens dominants n’ayant pas accepté de devenir les sujets de leurs anciens vassaux, la problématique conflictuelle sahélienne était donc posée. Les premières guerres touareg éclatèrent alors dès les années 1960 au Mali, puis au Niger et au Tchad où les Toubou se soulevèrent.
G. C. Dans votre livre, l’on suit constamment l’interaction entre la géographie et ce que vous définissez comme l’ethno-histoire. Pourquoi les décideurs français ne l’ont-ils pas vu ?
B. L. Là est en effet le cœur de la cascade d’erreurs faite par les décideurs politiques français alors que les militaires avaient, eux, bien compris le réel du terrain, mais ils n’ont pas été écoutés. Au Mali, nous étions en présence de deux guerres, celle des Touareg au nord, celle des Peul au sud, puis, plus tard, s’y est ajoutée celle de l’État islamique dans la région des trois frontières.
Au nord, et comme je n’ai cessé de le dire dans mes articles de L’Afrique réelle, la clé du problème était détenue par les Touareg aujourd’hui de nouveau rassemblés autour du « leadership » de Iyad Ag Ghali, chef historique des précédentes rebellions touareg. Politiquement, il eût fallu nous entendre avec ce chef Ifora avec lequel nous avions à l’origine des contacts, des intérêts communs, et dont le combat est d’abord identitaire avant d’être islamiste. Or, par idéologie, par refus de prendre en compte les constantes ethniques séculaires, ceux qui font la politique africaine française ont considéré tout au contraire qu’il était l’homme à abattre… Le deuxième conflit, celui du sud (Macina, Liptako, nord du Burkina Faso et région des trois frontières), a, lui aussi, des racines ethno-historiques et leur élément moteur est constitué par certains ensembles peul.
G. C. Vous écrivez que le djihadisme est « le plus souvent le paravent du narco-trafic ». Les deux maux sont donc étroitement imbriqués ?
B. L. Une autre erreur de Paris fut d’avoir « essentialisé » la question en qualifiant systématiquement de djihadiste tout bandit armé ou même tout porteur d’arme. Or, dans la plupart des cas, nous étions en présence de trafiquants se revendiquant du djihadisme afin de brouiller les pistes. Parce qu’il est plus valorisant de prétendre combattre pour la plus grande gloire du prophète que pour des cartouches de cigarettes, des cargaisons de cocaïne ou pour le contrôle des voies de migration vers l’Europe. D’où la jonction entre trafic et religion, le premier se faisant dans la bulle sécurisée par l’islamisme. L’erreur de la France fut d’avoir refusé de voir que nous étions face à l’engerbage de revendications ethniques, sociales, mafieuses et politiques, opportunément habillées du voile religieux, avec des degrés différents d’importance de chaque point selon les moments.
G. C. Vous expliquez qu’une autre erreur française fut d’avoir globalisé la question alors qu’il était impératif de la régionaliser.
B. L. Très exactement car Paris n’a pas voulu voir que l’EIGS (État islamique dans le Grand Sahara) et AQMI (Al-Qaïda pour le Maghreb islamique) ont des buts différents. L’EIGS qui est rattaché à Daech a pour objectif la création dans toute la bande sahélo-saharienne d’un vaste califat transethnique remplaçant et englobant les actuels États. De son côté, AQMI étant l’émanation locale de larges fractions des deux grands peuples à l’origine du conflit, à savoir les Touareg au nord et les Peul au sud, ses chefs locaux, le Touareg Iyad Ag Ghali et le Peul Ahmadou Koufa, ont des objectifs d’abord locaux et ils ne prônent pas la destruction des États sahéliens. Paris n’a pas vu qu’il y avait une chance à la fois politique et militaire à saisir, ce que je n’ai pourtant jamais cessé de dire et d’écrire, mais en France, on n’écoute pas les avis des « hérétiques »… Résultat : les décideurs parisiens ont donc refusé catégoriquement tout dialogue avec Iyad ag Ghali. Bien au contraire, le Président Macron déclara même qu’il avait donné comme objectif à Barkhane de le liquider… Contre ce que préconisaient les chefs militaires de Barkhane, Paris s’obstina donc dans une stratégie « à l’américaine », « tapant » indistinctement tous les GAT (groupes armés terroristes) péremptoirement qualifiés de « djihadistes », refusant ainsi toute approche « fine »… « à la française »…
G. C. Quel est le rôle de Wagner dans la région sahélienne ?
B. L. Je vais être très clair : je refuse cette manie d’attribuer à d’autres les causes de nos échecs. Si Wagner a pris notre place en RCA, c’est parce que Sarkozy nous a fait évacuer Birao, verrou de toute cette partie de l’Afrique que les Russes, qui eux savent lire une carte, ont tout naturellement occupée. Ensuite parce que Hollande a fait distribuer des couches-culottes par nos armées alors qu’il fallait taper et très fort la Seleka. Nous avons ainsi perdu la confiance de nos alliés locaux et tout notre prestige. Les Russes n’ont plus eu qu’à cueillir le fruit mûr que nous avions laissé sur l’arbre… Au Mali, ce fut la même chose et je l’ai longuement expliqué au début de cet entretien.
Mais, plus généralement, à travers le rejet de la France, ce sont les « valeurs » de l’Occident que l’Afrique rejette. Le continent qui, dans sa globalité, se reconnaît dans les valeurs naturelles familiales voit avec un haut-le-cœur le « mariage pour tous », les délires LGBT ou encore le féminisme castrateur de toute virilité proposés comme « valeurs universelles » par l’Occident. Pour les Africains, il s’agit là d’une preuve de décadence. Voilà pourquoi la Russie apparaît, au contraire, comme un contrepoids civilisationnel à la broyeuse moralo-politique occidentale.
Quant à la démocratie « à la française », elle y est vue comme une forme de néocolonialisme. D’autant plus que proposer aux Africains comme solution à leurs problèmes l’éternel processus électoral, le mirage du développement ou la recherche de la bonne gouvernance relève du charlatanisme politique… Les événements démontrent en effet constamment qu’en Afrique, démocratie = ethno-mathématique, ce qui a pour résultat que les ethnies les plus nombreuses remportent automatiquement les élections. Voilà pourquoi, au lieu d’éteindre les foyers primaires des incendies, les scrutins les ravivent. Quant au développement, tout a déjà été tenté en la matière depuis les indépendances. En vain. D’ailleurs, comment peut-on encore oser parler de développement quand il a été démontré que la suicidaire démographie africaine en interdit toute possibilité ?
G. C. Alors, quel avenir ?
B. L. Plusieurs dizaines des meilleurs enfants de France sont tombés ou sont revenus mutilés pour avoir défendu un Mali dont les hommes émigrent en France plutôt que se battre pour leur pays. Mais, exigé par les actuels dirigeants maliens à la suite des multiples maladresses parisiennes, le retrait français a laissé le champ libre aux GAT, leur offrant même une base d’action pour déstabiliser le Niger, le Burkina Faso et les pays voisins. Le bilan politique d’une décennie d’implication française est donc catastrophique.
La France est aujourd’hui face à un rejet global. Si le Niger, un pays plus que fragile et où nous venons de replier nos forces, devait à son tour connaître un coup d’État, la situation deviendrait alors problématique et le repli vers le littoral une urgence. Mais par quelles voies de retrait ? Les hommes pourront toujours être évacués par voie aérienne, mais quid des véhicules et du matériel, puisque nous ne disposons pas d’avions gros porteurs ?
L’urgente priorité est donc de savoir ce que nous faisons dans la bande sahélo-saharienne où nous n’avons pas d’intérêts, y compris pour ce qui est de l’uranium que l’on trouve ailleurs. Il nous faut donc définir enfin, et très rapidement, nos intérêts stratégiques actuels et à long terme afin de savoir si, oui ou non, nous devons nous désengager, à quel niveau et, surtout, sans perdre la face.
Plusieurs leçons doivent être tirées d’un colossal échec dont, il faut le redire, les décideurs politiques sont seuls responsables. À l’avenir, il nous faudra privilégier les interventions indirectes ou les actions rapides et ponctuelles menées à partir de navires, ce qui supprimerait l’inconvénient d’emprises terrestres perçues localement comme une insupportable présence néocoloniale. Une redéfinition et une montée en puissance de nos moyens maritimes et de nos forces de projection seraient alors nécessaires.
Enfin et d’abord, nous devrons laisser l’ordre naturel africain se dérouler. Cela implique que nos intellectuels comprennent enfin que les anciens dominants n’accepteront jamais que, par le jeu de l’ethno-mathématique électorale, et uniquement parce qu’ils sont plus nombreux qu’eux, leurs anciens sujets ou tributaires soient maintenant leurs maîtres. Cela choque les conceptions éthérées de la philosophie politique occidentale, mais telle est pourtant la réalité africaine. Plus que jamais, il importe donc de méditer cette profonde réflexion que le gouverneur général de l’AOF fit en 1953 : « Moins d’élections et plus d’ethnographie, et tout le monde y trouvera son compte… » En un mot, le retour au réel, le renoncement aux « nuées », ce qui passe par la connaissance de la géographie et de l’histoire, et tel est le but de mon livre et de ses nombreuses cartes.